
Les deux sous-marins de type Agosta, ex-Bévéziers et La Praya, sur le point d’être démantelés à Brest en novembre 2020. Crédit : Ewan Lebourdais – http://Ewan-photo.fr
Un jour de l’année 1897, un capitaine anglais de passage à Toulon se vanta devant un jeune officier de marine français de commander un navire nommé Waterloo. Le Français répliqua simplement : « En France, nous n’avons pas assez de bâtiments pour leur donner le nom de toutes nos victoires. » C’était bien répondu !
En France, l’idée de donner à certains navires de la marine de guerre des noms de batailles victorieuses remonte à la période révolutionnaire. Elle fut par la suite développée au XIXe siècle, notamment sous le Premier Empire et la Monarchie de Juillet.
A ma connaissance, le premier vaisseau concerné fut le Jemappes, un 74 canons mis en chantier à Rochefort en 1790. Initialement nommé l’Alexandre, il fut renommé le Jemappes en janvier 1793, deux mois après la victoire de Jemappes contre l’armée autrichienne, le 6 novembre 1792.
Le Jemappes fut rapidement suivi par le 74 canons le Wattignies (1794), du nom de la victoire du général Jourdan sur les Autrichiens, le 16 octobre 1793. Un autre vaisseau de 74 canons devait en outre être nommé le Fleurus (bataille du 26 juin 1794), mais il ne fut jamais construit.
Étonnamment, aucun vaisseau de la marine de la Révolution ne fut nommé Valmy, victoire du général Kellermann sur les Prussiens le 20 septembre 1792. Un demi-siècle plus tard, pendant la Monarchie de Juillet, ce nom sera donné à un grand 120 canons lancé en 1847, sans doute parce que le roi Louis-Philippe, alors duc de Chartres, avait pris part à cette bataille. Il avait d’ailleurs également participé à la bataille de Jemappes, citée plus haut. C’est pourquoi un second vaisseau lancé à Lorient en 1840 porta également ce nom, il portait 100 canons. Nous y reviendrons.
La marine du Consulat conserva l’habitude de célébrer les victoires militaires françaises en donnant leurs noms à des vaisseaux. Un vaisseau de 74 canons, le Sceptre qui avait été renommé la Convention en 1792, fut une nouvelle fois renommé le Marengo en 1800, en référence à la bataille de Marengo contre les Autrichiens en Italie du Nord, le 14 juin 1800. Un second vaisseau portera ce nom dés 1802, suite à la condamnation du premier.
En novembre 1801, un vaisseau de 74 canons en construction à Lorient depuis peu fut nommé l’Algésiras, du nom de la victoire remportée par l’escadre française du contre-amiral Linois contre la marine britannique le 13 juin 1801. Il s’agit du premier bâtiment dont le nom rappelle une victoire navale (et non terrestre comme auparavant). Le navire sera lancé trois ans plus tard, le 8 juillet 1804.
On constate que l’idée n’était pas jusqu’alors de rappeler des batailles anciennes. A chaque fois, les vaisseaux évoqués – dans tous les cas de « simples » 74 canons – furent officiellement nommés ou renommés quelques semaines ou mois après le déroulement de la bataille célébrée. L’objectif était avant tout de glorifier le régime en place et non de rappeler quelques batailles d’un autre temps. L’exemple de la bataille de Marengo, en 1800, où Napoléon Bonaparte commandait en personne l’armée française, est particulièrement révélateur. La même année, le général Moreau, rival politique de Napoléon, remporta plusieurs victoires en Allemagne contre les Autrichiens. Le nom d’aucune de ces batailles ne fut donné à un bâtiment français.
Napoléon comprit très vite l’intérêt qu’il pouvait avoir à donner aux navires de guerre des noms de victoires, « ses » victoires en fait ! Lorsqu’il prit Venise en 1797 alors qu’il n’était encore que général, il prit l’initiative de renommer l’ensemble des navires vénitiens présents dans le port et donna aux frégates les noms de ses plus belles victoires remportées durant la campagne d’Italie : Mantoue, Leoben, Montenotte, Lonato, Lodi, Rivoli.
La multiplication des batailles et des victoires sous le Premier Empire entraina en conséquence la multiplication de vaisseaux nommés d’après celles-ci : Ulm, Austerlitz, Donawerth, Iéna, Breslaw, Pulstuck, Golymin, Friedland, Eylau, Wagram. Symboliquement, les noms Arcole et Rivoli furent également donnés à des vaisseaux construits pour la Marine française à l’arsenal de Venise. Nouveauté notable : les vaisseaux de 74 canons n’étaient plus les seuls concernés. Des 80 et des 118 canons furent également nommés d’après des batailles victorieuses.

Le lancement du vaisseau de 80 canons le Friedland à Anvers, le 2 mai 1810, en présence de Napoléon. Par Mattheus Ignatius van Bree (1773-1839).
Il est intéressant de constater que la plupart des bâtiments cités conservèrent leur nom après la chute de Napoléon. Les plus importants, les vaisseaux de 118 canons l’Austerlitz (1808) et le Wagram (1810) ne furent pas renommés malgré la Restauration. Ils furent tous les deux rayés des listes en 1837. Un autre bâtiment de force importante, le 110 canons l’Iéna (1814), fut quant à lui renommé le Duc d’Angoulême par Louis XVIII mais reprit son nom d’origine en 1830, au début de la Monarchie de Juillet.
La Restauration continua de donner à certains de ses vaisseaux des noms de victoires. Le Formidable, vaisseau de 118 canons en construction à Toulon fut renommé le Trocadéro suite à la victoire du Trocadéro le 31 août 1823 du corps expéditionnaire français sur les révolutionnaires libéraux espagnols à Cadix. Le navire fut lancé l’année suivante en 1824.
Un vaisseau de 90 canons mis en chantier à Toulon en 1827 fut nommé le Fontenoy, référence à la victoire française le 11 mai 1745 pendant la guerre de Succession d’Autriche. Pour la première fois, c’est une bataille datant de l’Ancien Régime qui fut mise en avant. Et ce n’est évidemment pas un hasard si cette nouveauté arriva sous le règne de Charles X, connu pour ses idées ultraroyalistes.
En 1829, c’est un vaisseau de 100 canons ordonné à Toulon qui fut nommé le Navarin, hommage à la victoire le 20 octobre 1827 de l’escadre réunie pendant la guerre d’indépendance de la Grèce par le Royaume-Uni, la France et la Russie contre la flotte ottomane. Le Navarin fut le deuxième vaisseau français portant le nom d’une bataille navale après l’Algésiras. Maintenu sur cale, en réserve, il fut lancé bien tardivement, le 26 juillet 1854, pour prendre part à la guerre de Crimée. Il servit essentiellement comme transport en mer Noire en 1855-1856 puis lors de l’expédition du Mexique la décennie suivante.

La bataille de Navarin (1827), par George Philip Reinagle (1802-1835), peintre de marine anglais qui assista au combat. Le vaisseau au premier plan arbore le pavillon blanc du royaume de France, il s’agit probablement du Breslaw qui vint en aide à un vaisseau russe.
La Monarchie de Juillet est une époque particulièrement intéressante lorsqu’on s’intéresse à l’onomastique navale, notamment parce que les noms de plusieurs bâtiments jugés trop légitimistes furent modifiés dés le début du régime en 1830 : le trois-ponts le Duc de Bordeaux en construction à Cherbourg fut renommé le Friedland ; à Toulon, le vaisseau de 100 canons le Dauphin Royal fut renommé le Fleurus ; à Lorient, le vaisseau de 90 canons le Royal Charles devint le Jemappes (déjà cité) ; à Rochefort, le vaisseau encore en chantier le Lys fut quant à lui renommé l’Ulm. L’occasion ici de rappeler une nouvelle fois que le choix du nom d’un bâtiment de guerre est éminemment politique.
Plus tard, le 28 novembre 1839, plusieurs vaisseaux encore en construction furent renommés l’Austerlitz, le Donawerth, le Breslaw, l’Eylau et le Wagram. Cinq batailles napoléoniennes. Le fait que ces changements de noms coïncident avec le retour des cendres de l’Empereur en France quelques mois plus tard n’est pas un hasard !
Sous la Monarchie de Juillet, la majeure partie de la flotte portait des noms de batailles. A l’image de la transformation du château de Versailles en musée historique, l’objectif était de réunir les Français – royalistes, bonapartistes, républicains, si divisés depuis quarante ans – autour d’une histoire militaire commune et glorieuse. Bien sur, le régime mit également en avant les batailles auxquelles le roi des Français participa dans sa jeunesse, Valmy notamment.

Le Valmy (1847), par François Roux (1811-1882). Il fut le plus grand vaisseau construit par la France à l’époque de la marine à voile.
La marine du Second Empire conserva naturellement les noms renvoyant aux plus belles victoires napoléoniennes. En 1853, deux vaisseaux de 90 canons de type Napoléon furent nommés Algésiras et Arcole. Ce dernier fit partie de l’escadre française réunie à Cherbourg en août 1858 à l’occasion de la visite de l’empereur Napoléon III et de la reine Victoria. Sur les neuf vaisseaux qui composaient cette escadre, cinq portaient le nom d’une victoire napoléonienne : l’Arcole, l’Eylau, l’Austerlitz, le Donawerth, l’Ulm. Nul doute que les Britanniques le remarquèrent…
Le régime n’oublia pas non plus d’honorer ses propres victoires : en 1859, deux cuirassés furent nommés Magenta et Solférino, du nom des batailles remportées par Napoléon III en Italie cette même année.
Dans les dernières années du régime impérial, des frégates cuirassées furent encore baptisées Marengo (1865) et Friedland (1866). Comme à l’époque de la Monarchie de Juillet, une importante partie des navires constituant la flotte portait des noms de victoires. Cet état de fait changea sous la IIIe République, qui peu à peu abandonna cette pratique. Avec le temps, les noms cités jusqu’alors disparurent des listes de la Marine, à l’image du cuirassé Iéna (1898) qui explosa en pleine rade de Toulon le 12 mars 1907.
Les bâtiments français portant des noms de batailles furent rares au XXe siècle. Citons toutefois les contre-torpilleurs Valmy et Verdun lancés en 1928. Citons également les dragueurs de mines de type MSO. De conception américaine, ils furent cédés à la France dans les années 1950 et nommés d’après des noms de batailles et combats s’étant déroulés durant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d’Indochine (1946-1954) : Narvik, Ouistreham, Alençon, Berneval, Bir Hacheim, Cantho, etc. Deux autres bâtiments d’origine américaine incorporés dans la Marine française après la Seconde Guerre mondiale furent les porte-avions Dixmude et Bois Belleau, ainsi nommés en référence à deux batailles de la Première Guerre mondiale.
Entre 1934 et 1936, trois sous-marins de 1500 tonnes lancés à Cherbourg avaient en outre été nommés Agosta, Bévéziers et Ouessant, référence à trois victoires de la Marine française à l’époque de l’Ancien Régime : les deux premières sous le règne de Louis XIV, la troisième sous celui de Louis XVI. Quarante ans plus tard, une nouvelle classe de sous-marins d’attaque français construits à Cherbourg reçut les trois mêmes noms, auxquels s’ajouta La Praya, référence à une victoire en 1781 du bailli de Suffren contre la marine britannique pendant la guerre d’Indépendance américaine. Ce fut les seules et uniques fois que les victoires de la Marine royale furent ainsi honorées.
Aujourd’hui, un rapide coup d’œil sur la liste des principaux bâtiments de la Marine nationale laisse apparaitre deux grands types de noms : ceux des grands marins, à l’image des futurs sous-marins d’attaque de type Suffren et de nombreuses frégates, dont les futures FDI qui porteront les noms d’amiraux du XXe siècle ; et ceux des régions françaises, attribués aux FREMM. L’une des rares exceptions à ce constat sont les porte-hélicoptères amphibies (ex-BPC), dont le Dixmude, lancé à Saint-Nazaire en 2010, nom précédemment cité qui fait référence à la bataille de Dixmude, durant laquelle la brigade de fusiliers marins se sacrifia en octobre 1914. Ce choix de nom avait étonné à l’époque, est-il le signe avant coureur d’un retour à la vieille pratique de donner des noms de victoires à nos navires de guerre ? Rien n’est moins sûr…
Sources :
– Fremy, Raymond. Des noms sur la mer. Trois cents ans d’une marine par les noms de ses bâtiments
– Le Conte, Pierre. Répertoire des navires de guerre français
– Roche, Jean-Michel. Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours
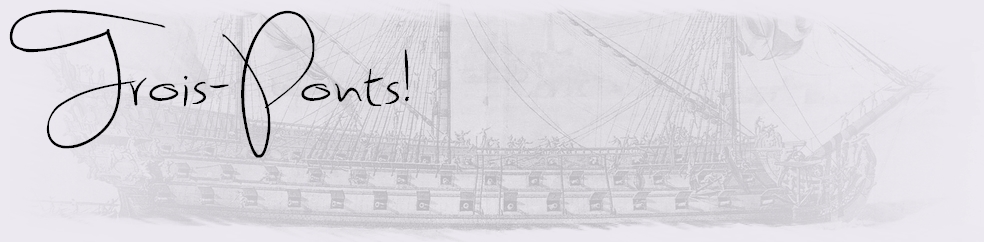



Merci pour ce toujours très intéressant article !
C’est vraiment très riche et passionnant. Quel plaisir de lire l’Histoire maritime et navale.
Excellent article qui pourrait servir de référence au cabinet du chef d’état-major de la Marine…